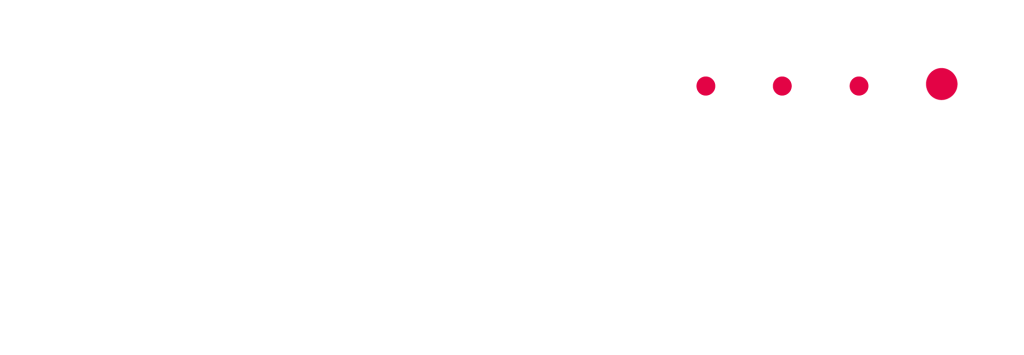Traditionnellement, les entreprises disposaient déjà d’outils de protection avec la propriété intellectuelle ou encore le droit pénal contre l’espionnage économique et industriel. Cependant, en raison d’un manque d’uniformisation en Europe, le lobbying des multinationales souhaitait l’adoption d’un dispositif comparable à celui de la Chine et des Etats-Unis.
Cette directive définit alors comme « secret d’affaires », les informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :
« a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,
b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes,
c) elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ».
Au plus tard le 9 juin 2018, les Etats doivent inscrire dans leur arsenal juridique des «mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’une réparation au civil soit possible en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicites de secrets d’affaires» (article 6).
La directive a adopté une définition large du secret d’affaires: il revient aux entreprises de décider si une information a une valeur économique et donc si elle peut être divulguée. Pour les eurodéputés Verts, le risque est celui d’un manque d’accès à l’information dans les domaines sanitaires et environnementaux.
En effet, cette directive avait suscité de nombreux débats. Les journalistes et les lanceurs d’alerte considéraient que cette directive constitue une atteinte à la liberté d’informer. Ils ont alors obtenu des exceptions. Une demande de réparation fondée sur la directive sera rejetée dans deux cas « pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias » et « pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ».
Ainsi, la protection du secret d’affaires ne peut pas être opposée à un journaliste dans le cadre de sa fonction. Cela signifie en pratique que la charge de la preuve reposera sur l’entreprise qui doit démontrer que le journaliste a révélé des informations confidentielles dans un autre but que l’exercice le droit à la liberté de l’information.
Cependant, la protection est bien plus faible concernant les lanceurs d’alerte. En effet, la directive ne leur sera pas opposée à condition qu’ils prouvent leur bonne foi. Le Rapporteur spécial des Nations unies à la liberté d’expression a estimé que « les motivations du lanceur d’alerte au moment de la révélation ne devraient pas avoir d’importance » pour lui accorder une protection. L’Union Européenne a alors envisagé d’adopter une directive spécifique à la protection des lanceurs d’alerte, encore faut-il que cet engagement soit mise en oeuvre dans un délai raisonnable.
Par Romane COUDOU, stagiaire